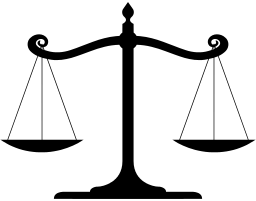Rupture conventionnelle nullité de la convention en l’absence d’entretien
Pour être valide, toute rupture conventionnelle homologuée nécessite la tenue d’un ou plusieurs entretiens. À défaut, la convention de rupture est frappée de nullité. Il appartient toutefois à celui qui invoque une absence d’entretien d’en établir la preuve.
Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-21.609
Le résumé de l’affaire
Un salarié conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur. Soutenant qu’aucun entretien ne s’était tenu au préalable à la conclusion de la convention, il demande son annulation. Les premiers juges lui donnent raison en relevant que, si la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, l’employeur n’apportait aucun élément pour en attester la réalité. Cet avis n’est pas partagé par la Cour de cassation.
La solution des juges
Le défaut du ou des entretiens prévus par le Code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture. C’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence. Pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l’absence d’entretien [les premiers juges retiennent] que l’employeur ne produit aucun élément matériel vérifiable permettant d’en attester la réalité. En statuant ainsi [ils ont] inversé la charge de la preuve.
La convention est nulle à défaut d’entretien
Le principe de la rupture conventionnelle est convenu par les parties lors d’un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister [C. trav., art. L. 1237-12]. C’est au cours de l’entretien que sont convenus le principe et les conditions de la rupture (date, indemnités, etc.), qui seront ensuite formalisées dans la convention.
Dans notre affaire, salarié et employeur avaient signé une convention de rupture, qui avait été homologuée par l’administration. Le salarié – qui n’avait pas fait usage de son droit de rétractation – soutenait toutefois que la convention n’était pas valide, car aucun entretien ne se serait tenu au préalable à sa conclusion. Avant même de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, la Cour de cassation précise pour la première fois que la sanction applicable au défaut d’entretien est la nullité de la convention de rupture.
Plusieurs raisons, détaillées dans une note de la Cour de cassation jointe à l’arrêt, peuvent expliquer cette décision. Selon les juges, il ressort des textes relatifs à la rupture conventionnelle que l’entretien est une condition substantielle de cette dernière, par laquelle les partenaires sociaux et le législateur ont entendu garantir la liberté du consentement des parties [C. trav., art. L. 1237-11]. La rupture conventionnelle suppose en effet que les parties conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre. Celle-ci relève donc d’une volonté commune qui doit être concertée, ce qui suppose une rencontre et une discussion et, par là même, un ou plusieurs entretiens.
La rupture conventionnelle est donc indissociable de la tenue d’un entretien, sans lequel elle ne peut être conclue. La seule sanction envisageable en l’absence d’entretien est ainsi la nullité de la convention de rupture, ce qui, a priori, fait produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À NOTER : si l’entretien préalable à la rupture doit exister, il n’est toutefois soumis à aucun formalisme particulier. Aucun délai n’est par exemple exigé entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention [Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-19.268] et l’absence d’information du salarié par l’employeur de la possibilité de se faire assister n’entraîne pas la nullité de la rupture [Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-27.594].
Preuve de l’absence d’entretien
Si la sanction applicable à défaut d’entretien est la nullité de la convention de rupture, encore faut-il établir qu’aucun entretien n’a eu lieu. Dans notre affaire, la convention de rupture qui avait été homologuée par l’administration mentionnait la tenue de deux entretiens, ce que le salarié contestait. Pour condamner l’employeur, les premiers juges avaient estimé que celui-ci aurait dû produire des éléments permettant d’attester la réalité de ces entretiens.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, estimant que la charge de la preuve a été inversée. La rupture conventionnelle étant une rupture bilatérale du contrat de travail, rien selon les juges, ne justifiait que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En outre, la convention de rupture avait été établie selon un formulaire dans lequel était bien indiqué que deux entretiens s’étaient tenus. Cette convention, non contestée pendant le délai de rétractation et homologuée par l’administration qui est chargée d’effectuer un contrôle [Circ. DGT n° 2008-11, 22 juill. 2008] contredisait donc le salarié.
Puisque c’est le salarié qui invoquait l’absence de tenue d’entretiens malgré les mentions de la convention, c’était donc à lui et non à l’employeur de rapporter la preuve de leur absence. La Cour de cassation applique ici des règles de preuve ordinaire : c’est à celui qui allègue un fait de démontrer sa réalité [C. proc. civ., art. 9].
Après la décision de la Cour de cassation, notre affaire sera à nouveau jugée par une cour d’appel. Le salarié pourra à ce moment-là tenter de démontrer que les deux entretiens allégués par l’employeur n’ont pas eu lieu.
À NOTER : pour la Cour de cassation, faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur aurait en pratique eu pour effet l’envoi au salarié d’une convocation à l’entretien. Ce moyen aurait, selon les juges, imposé un formalisme contraire à la volonté du législateur et des partenaires sociaux.
Le licenciement pour inaptitude devient sans cause réelle et sérieuse si l’employeur est fautif
La présente affaire concerne 3 salariés, exerçant les fonctions de VRP.
Ils sont licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais ils décident de saisir la juridiction prud’homale, estimant que l’inaptitude avait été causée par un comportement fautif de leur employeur, qui leur avait imposé une charge de travail excessive.
La cour d’appel puis la Cour de cassation s’accordent pour donner raison aux salariés.
Doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lorsque ladite inaptitude résulte en fait d’un comportement fautif de l’employeur.
L’attestation Pôle emploi doit être délivrée même en cas de démission
L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission du salarié. C’est ce que précise la Cour de cassation dans une décision du 15 mars 2017.
Un salarié avait saisi la justice pour demander des dommages-intérêts à son employeur qui ne lui avait pas délivré l’attestation Pôle emploi après sa démission.
La cour d’appel avait rejeté la demande du salarié au motif que la délivrance d’une attestation Pôle emploi ne s’imposait pas, le salarié ne pouvant pas prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de sa démission.
Mais l’arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées du code du travail et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission.
On rappellera qu’en cas de non-respect de cette obligation l’employeur encourt une amende de 5e classe, soit 1 500 € pour une personne physique ou 7 500 € pour une personne morale.
Textes de référence
Harcèlement managérial : l’inaction du responsable RH est fautive
Dans un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé du licenciement d’une responsable RH ayant cautionné, en les laissant perdurer sans réagir, les agissements de harcèlement moral commis par un directeur d’établissement sur ses subordonnés.
Cass. soc., 8 mars 2017, nº 15-24.406 FS-DCass. soc., 8 mars 2017, nº 15-23.503 FS-D
En matière de harcèlement moral, l’auteur direct des agissements n’est pas le seul à encourir une sanction disciplinaire. Les cadres de direction qui ont laissé perdurer la situation en toute connaissance de cause, sans prendre aucune mesure alors qu’ils étaient en capacité de le faire, s’exposent également à un licenciement. En témoigne une récente affaire examinée par la Cour de cassation en mars dernier, à propos notamment d’une responsable RH licenciée pour avoir cautionné les agissements d’un directeur d’établissement.
À l’occasion de ce contentieux, la Haute juridiction a par ailleurs clairement validé la mesure de mise en disponibilité provisoire prise par l’employeur durant le temps nécessaire à l’enquête interne, avant même l’engagement de la procédure disciplinaire.
Harcèlement moral managérial
Les deux affaires tranchées le 8 mars 2017 ont pour point de départ une enquête interne diligentée, au sein d’un hypermarché, après qu’un salarié a démissionné en dénonçant la politique de harcèlement moral menée par le directeur du magasin. Le rapport d’enquête réalisé à partir du témoignage d’une trentaine de salariés s’est révélé accablant, évoquant un « climat de terreur », des humiliations, une perte de confiance, des démissions sous contrainte, la manipulation de proches collaborateurs, etc.
Le directeur de magasin a été licencié pour faute grave, entraînant dans son sillage le licenciement de la responsable RH et d’un contrôleur de gestion (pour cause réelle et sérieuse), tous deux employés au sein du magasin.
Selon les lettres de licenciement, ces deux cadres supérieurs, membres du comité de direction, auraient notamment cautionné les agissements inacceptables de leur responsable, sans intervenir, voire en y participant, manquant ainsi à l’obligation de sécurité pesant sur tout travailleur (C. trav., art. L. 4122-1).
La Cour de cassation a eu à connaître des deux litiges en contestation de la cause réelle et sérieuse. La Haute juridiction était toutefois saisie sur des moyens différents :
– selon la responsable RH, il ne pouvait lui être reproché des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables. En outre, son inertie serait due à l’absence de moyens organisationnels mis en place par la direction du groupe, qui lui auraient permis de dénoncer les agissements en question ;
– selon le contrôleur de gestion, sa mise en disponibilité pendant le temps de l’enquête interne s’analysait en une sanction, empêchant le prononcé ultérieur d’un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits.
Dans les deux cas, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Laisser-faire fautif
Dans la première affaire (nº 15-24.406), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ayant validé le licenciement de la responsable RH : « en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin avec lequel elle travaillait en très étroite collaboration, et en les laissant perdurer, la salariée [a] manqué à ses obligations contractuelles et [a] mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés ».
L’arrêt prend soin de relever que :
– la salariée était informée des agissements : « la salariée, qui travaillait en très étroite collaboration avec le directeur du magasin, avait connaissance du comportement inacceptable de celui-ci à l’encontre de ses subordonnés et pouvait en outre s’y associer » ;
– ses fonctions impliquaient une réaction de sa part : « elle n’a rien fait pour mettre fin à ces pratiques alors qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines, elle avait une mission particulière en matière de management, qu’il relevait de ses fonctions de veiller au climat social et à des conditions de travail « optimales » pour les collaborateurs ». De plus, la définition contractuelle de ses fonctions précisait bien qu’elle devait « mettre en œuvre, dans le cadre de la politique RH France, les politiques humaines et sociales », le responsable des ressources humaines étant « un expert en matière d’évaluation et de management des hommes et des équipes ».
Prononcé d’une mise en disponibilité durant la phase d’enquête
Dans la seconde affaire (nº 15-23.503), la Cour de cassation a également admis la possibilité pour l’employeur de décider d’une mise en disponibilité provisoire des auteurs présumés, dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire et ce, pour les besoins de la réalisation d’une enquête interne liée à la dénonciation du harcèlement moral.
En l’occurrence, après la dénonciation des agissements de harcèlement moral commis par le directeur d’établissement, le contrôleur de gestion s’était vu notifier le 20 octobre, une mise en disponibilité avec maintien de la rémunération, le temps pour l’employeur d’auditionner librement les salariés souhaitant témoigner et de mesurer l’ampleur des faits. La mesure n’a duré que trois jours : dès la fin de l’enquête, le 24 octobre, il s’est vu notifier sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce même courrier lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Puis il a été licencié le 24 novembre suivant.
La Haute juridiction a refusé d’analyser cette mise en disponibilité en une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur (ce qui aurait rendu le licenciement ultérieur sans cause réelle et sérieuse). L’arrêt rappelle en effet le principe jurisprudentiel selon lequel « l’employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l’entreprise pourvu qu’il n’en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail » (v. déjà en ce sens : Cass. soc., 31 janvier 2012, nº 10-24.227). Si ces différentes conditions sont réunies, la mesure s’analyse alors en une mesure conservatoire (qui n’épuise pas le pouvoir disciplinaire) et non en une mesure disciplinaire. En l’occurrence, lesdites conditions étaient bien réunies :
– la mesure avait uniquement pour objet, non de sanctionner le salarié, mais de garantir les intérêts de l’entreprise, à savoir « permettre le déroulement serein de l’enquête interne rendue indispensable après la révélation de faits graves au sein du magasin où le salarié était affecté » ;
– le contrat de travail n’avait pas été durablement modifié, compte tenu de la durée de trois jours de la mise en disponibilité. D’autre part, dès les résultats de l’enquête interne, la procédure de licenciement avait été engagée.
Le licenciement a donc également été jugé fondé.
Les employeurs paieront une taxe de 40 euros par salarié détaché
Un décret du 3 mai 2017, publié vendredi, fixe le montant de la contribution due par les employeurs étangers qui détachent des salariés en France. Cette taxe, prévue à l’article 106 de la loi Travail, est destinée à compenser les coûts liés au système de traitement dématérialisé des déclarations de détachement. Elle est fixée à 40 € par travailleur. Les employeurs payeront cette contribution par télépaiement sur un site dédié, au moment d’effectuer leur déclaration ou attestation de détachement. Le paiement sera réalisé par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre lorsque ces derniers sont tenus d’effectuer une déclaration subsidiaire de détachement (article L. 1262-4-1 du code du travail). Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication d’un arrêté qui fixera les modalités de fonctionnement du système de télépaiement (au plus tard le 1er janvier 2018).